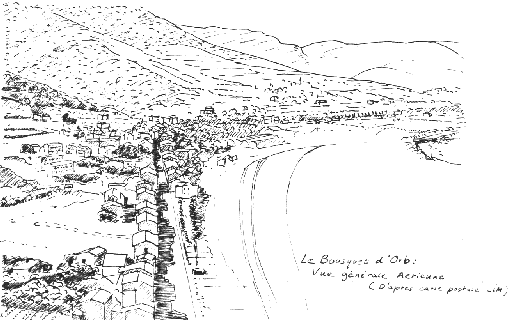A treize heures, la vente était terminée et
souvent il ni restait plus de chapeaux ou de casquettes. Alors on allait
déjeuner à l'auberge où on faisait bonne chère. Ensuite, il ne restait plus
qu'à emballer la marchandise restante,
enlever la tente et retourner à la maison en fin d'après midi.
En 1904, mon père a pris la représentation
pour la région des "Huiles d'olive Bouscaren" de Gigean (dans
l'Hérault). Deux fois par an, il faisait la tournée des villages avec M.
Carrel, représenta général. Ces huiles, de très bonne qualité, donnaient
satisfaction à clientèle qui restait fidèle. Les carnets de commandes, bien
garnis, se traduisaient par une rémunération substantielle.
En automne, mon père faisait le distillateur
ambulant pour les bouilleurs de cru du Bousquet et des villages voisins. Chaque
propriétaire viticulteur avait droit à faire distiller du vin, dans la limite
de 1000 degrés d'alcool pur, sans payer de droits. Quelques fois mon père
disposait d'un local pour installer son alambic, mais le plus souvent celà se
passait à l'extérieur sur la place du village. Il y avait autour de l'installation
de nombreux curieux qui ne manquaient pas de déguster le premier jet d'alcool.
Avec des extraits "Noirot", mon père faisait toutes sortes de
liqueurs pour la consommation familiale.
Toutes ces activités de mon père avaient
atteint leur plein rendement en 1910, ce qui permettait à mes parents de vivre
dans l'aisance et la prospérité.
La déclaration de guerre, en Août 1914, a mis
fin à cette heureuse situation. Les trois quarts de la clientèle de mon père
ont été mobilisés; il ne restait plus que les vieux qui se faisaient raser une
fois par semaine, et les jeunes qui n'avaient pas encore de barbe. Les
économies commençaient à fondre et mon père souffrait de cette activité
réduite. Aussi, lorsque le gérant de l'Etoile du Midi, Sté à Succursales Multiples
de Millau, a donné sa démission en 1915, mon père a fait une demande pour le
remplacer et il a obtenu satisfaction. Ce magasin d'épicerie était situé juste
en face du magasin de coiffeur de sorte que mon père pouvait continuer
d'exercer son métier tout en aidant ma mère à l'épicerie.
Par l'intermédiaire d'un importateur
Espagnol, qui avait un commerce à Bédarieux, mon père pouvait se procurer tous
les produits qui manquaient à cette époque: pâtes, chocolat, sucre et autres
denrées alimentaires. En outre mon père avait obtenu la fourniture de tous les
produits d'épicerie nécessaires à la subsistance des prisonniers de guerre
allemands qui étaient employés à la mine et la verrerie. De sorte que ce
nouveau commerce marchait à merveille et mon père a alors décidé de vendre le
fond de coiffeur au début de l'année 1918.
Malheureusement, ma mère a eu la grippe
espagnole en 1917, qui a fait tant de victimes, et elle n'a pas pu se remettre
de cette longue et épuisante maladie. Le docteur lui a demandé de choisir entre
le repos complet ou le cimetière!
En 1920, mes parents ont dû renoncer à
exploiter cette épicerie et le bénéfice acquis pendant ces cinq années a été
partiellement absorbé par les pertes dues aux dettes des réfugiés du Nord de la
France, qui sont rentrés chez eux dès la proclamation de l'armistice et par les
larcins commis par l'employée que mes parents avaient dû prendre pendant la
maladie de ma mère.
Mes parents se sont retirés dans la maison de
campagne du Pont d'Orb et ils comptaient pouvoir vivre avec le revenu de leurs
économies et les loyers de la maison du Bousquet d'Orb. Mais la chute du franc
et la crise économique d'après guerre ont fait monter les prix et mon père a dû
reprendre du service. Il a commencé par faire le cinéma ambulant dans les
villages voisins, en association avec son frère Ernest qui corsait le programme
par des chansons comiques. Celà a bien marché pendant deux ans et puis les
habitants de ces villages se sont lassés des films à épisodes qui étaient de
règle à cette époque du cinéma muet.
Après une période d'inactivité de deux ans,
mon père a acheté une distillerie à Bédarieux, en 1924, qui rapportait bien puisqu'en
six mois de travail, mes parents pouvaient vivre largement pendant un an. En
1931, ils ont vendu la distillerie et la maison pour venir s'installer chez
moi, à Bondy, après mon mariage. Le climat et l'indifférence des voisins ont
découragé mon père et mes parents ont décidé de repartir dans le midi, à
Lodève, où mon père a repris le métier de coiffeur en 1934 à l'âge de 68 ans.
En 1938, il a cessé son travail pour cause de maladie et il est décédé le 29
Juillet 1939, à l'âge de 73 ans.

V.
MES JEUX D'ENFANT
Lorsque j'étais petit, mes parents
m'envoyaient chez ma marraine pour jouer avec sa fille Odette qui avait le même
âge que moi. Il y avait aussi d'autres petites filles, dans ce quartier de la
gare où les parents de ma marraine tenaient un café. On jouait surtout au
"papa et à la maman" et j'étais forcément le papa, étant le seul
garçon de ce groupe d'enfants. Odette voulait être la maman et celà entraînait
des disputes avec les autres fillettes.
En 1910, mes parents louèrent le 2ème étage
de notre maison à un nouveau facteur qui venait d'être nommé au Bousquet d'Orb.
Il avait une fille, également du même âge que moi, ce qui me dispensait de me
déplacer pour jouer. Elle s'appelait Fernande et nous étions souvent ensemble,
soit chez nous, soit chez ses parents. Sa mère était charmante, mais son père
était très autoritaire.
Il est mort quelques années plus tard et sa
femme a dû retourner à Béziers, chez sa mère, pour y trouver du travail. J'ai
revu Fernande à plusieurs occasions, notamment pendant mes vacances, et elle
m'aimait toujours.
A six ans, j'ai fait mon entrée à l'école
primaire et j'ai abandonné les jeux avec les filles pour me joindre à mes
camarades de classe. A part les heures d'école et des repas, nous étions le
plus souvent dehors, dans les rues de la ville ou dans les environs.
On jouait souvent à la guerre avec des armes
de notre fabrication, qui étaient quelques fois dangereuses: lance-pierres,
sabres de bois, arbalètes, gourdins, etc.... Lorsque deux groupes différents se
rencontraient, la bataille était inévitable et celà se terminait par des plaies
et des bosses.
Comme tous les gosses, nous commettions de
mauvaises actions qui nous valaient de bonnes corrections par nos parents: on
tirait les sonnettes des maisons, on déplaçait les chariots et les brouettes
que les propriétaires récupéraient à plus d'un kilomètre, on ouvrait les portes
des basses-cours, on maraudait les fruits dans les jardins, etc....
Nous avions aussi des jeux pacifiques: les
billes, le cerceau, cache-cache, le gendarme et les voleurs, saute-mouton,
etc.... L'été nous passions la majeure partie du temps au bord de la rivière où
on se baignait à longueur de journée. On péchait à la ligne, au filet et aussi
à la main, bien que ce soit interdit.
Le curé de la paroisse choisissait ses
enfants de coeur parmi les meilleurs élèves de l'école, qui étaient aussi les
plus débrouillards. Je faisais partie de cette élite et je fus enfant de coeur
pendant plusieurs années. A la messe, nous étions chargés de faire la quête et
de distribuer le pain béni. Pour les enterrements, nous étions autorisés à
faire une quête en notre faveur, ce qui nous permettait d'acheter des
friandises après la cérémonie.
A cette époque on ne fabriquait pas encore de
bicyclettes pour les enfants. J'avais eu un cheval mécanique, puis un tricycle,
mais je rêvais d'avoir un vélo. Mon père a pu s'en procurer un qui appartenait
à un homme de petite taille et qui avait été fabriqué spécialement pour lui.
J'étais ainsi le seul enfant de la ville à avoir un vélo et j'étais heureux de
pouvoir le prêter à mes meilleurs camarades.
J'ai eu aussi un jeune renard que mon oncle
m'avait apporté et que j'avais apprivoisé. Il me suivait partout dans la
maison, mais il avait peur des chiens et il se sauvait au grenier dès qu'il en
sentait un qui entrait au magasin de mon père. Nous l'avons trouvé mort dans le
grenier où un chien l'avait poursuivi, malgré la surveillance de mes parents.
J'ai eu beaucoup de chagrin.
Pendant les grandes vacances, mes parents
m'envoyaient au Furou, chez nos cousins Chibaudel, pour me soustraire aux
fortes chaleurs de l'été et aussi pour changer d'air.
Le Furou se trouve sur la rive gauche de
l'Orb, tout près de sa source, à la limite du département de l'Aveyron. Ce
hameau, qui fait partie de la commune de Roqueredonde, ne comptait que trois maisons:
celle de nos cousins, une autre ferme et le château qui appartenait à la
famille Caunot, dont un membre s'est distingué dans l'aviation sous le
pseudonyme de Beaumont. Les Chibaudel avaient deux filles, Maria et Héléna, et
un fils. Maria a épousé en 1912 un camarade de régiment de son frère, M. Roux,
propriétaire de la Rouquette à Cabrières (Hérault). Je me, souviens très bien
de ce mariage où nous étions invités. La noce a duré plusieurs jours et mon
oncle Ernest jouait de l'accordéon pour faire danser les couples. Dans la nuit
il péchait des pleins paniers de truites et d'écrevisses à l'aide d'une
lanterne à acétylène.
Héléna s'est mariée plus tard, mais son frère
est resté célibataire.
Au Furou, on vivait surtout de l'élevage des
brebis qui produisaient des agneaux et du lait pour les caves de Roquefort.
On y récoltait du blé, de l'avoine, des
fruits et des légumes. Il y avait un four où on faisait le pain pour plusieurs
jours. Dans l'étable il y avait une paire de boeufs pour les labours et les
transports. Les poulets, lapins, pigeons, agneaux, gibiers, truites étaient au
menu. De sorte que nos cousins achetaient peu de choses à la ville.
C'était pour moi le paradis, où je pouvais
galoper dans les prairies et les sentiers de montagne, avec les jeunes enfants
qui étaient au château.
VI.
LES MOEURS et les COUTUMES du PAYS
Comme dans tous les pays qui bordent la Méditerranée,
les rôles du mari et de la femme étaient, à cette époque, nettement distincts
dans le ménage. Le mari gagnait l'argent nécessaire à la vie familiale et
s'occupait des travaux de la vigne et du jardin.
La femme était la maîtresse de la maison
familiale, qu'elle administrait avec compétence, et des enfants qu'elle élevait
dans le respect de l'obéissance et de la vertu.
Le mari jouissait d'une indépendance totale
et il occupait ses loisirs à la chasse, à la pêche, au jeu de boules et surtout
au café qui était pratiquement interdit aux femmes.
La femme avait peu de loisirs, à part les
bavardages chez les commerçants et les veillées avec les voisins qui se
passaient au coin du feu en hiver et sur le trottoir de la rue en été.
La plupart des habitants de la ville étaient
catholiques. Les enfants étaient baptisés dès leur naissance, généralement le
dimanche suivant. Ils allaient à la messe dès leur jeune âge, suivaient le
catéchisme et faisaient leur communion solennelle à l'age de 10 ans.
A l'église, lors des cérémonies, les femmes
occupaient la partie inférieure et les hommes étaient groupés dans la tribune
supérieure, Le dimanche, à la grande messe, les enfants de coeur distribuaient
du pain béni qui était offert gracieusement par commerçant ou une famille
aisée.
Pour les mariages, on jetait des dragées aux
enfants tout le long du cortège entre l'église et la maison de la mariée.
Lorsqu'un veuf ou une veuve se remariait, il
avait droit au charivari, qui consistait à faire beaucoup de bruit avec toutes
sortes d'instruments ou d'objets divers, devant sa maison, la veille du
mariage.
Pour un enterrement, on habillait le mort
avec son plus beau costume en faisant appel à une femme du pays qui avait l'habitude de cette pratique.
D'autres femmes passaient ensuite dans les maisons de la ville pour annoncer le
décès et la date de l'enterrement. Les amis de la famille venaient présenter leurs
condoléances et bénir le mort à la maison, avant la mise en bière. La plupart
des habitants assistaient à la cérémonie religieuse et à l'enterrement au
cimetière où la famille recevait les condoléances générales.
Tous les habitants du pays qui était un
dialecte de langue d'oc. (cafés, commerçants, mine, verrerie,) le patois.
Certains enfants entraient le français!
Les familles d'ouvriers qui ne disposaient
que de leur salaire pour vivre, pouvaient se procurer des ressources
complémentaires en ramassant dans les montagnes des asperges et des poireaux
sauvages au printemps, des arbouses et des mûres pour faire des confitures en
été, des châtaignes dans les bois communaux, des figues sauvages et des
champignons en automne.
Après les vendanges, le grappillage dans les
vignes étai t toléré et certains habitants pouvaient ainsi faire leur provision
de vin pour toute l'année.
A la mine, on pouvait se procurer du charbon
à bon compte: 5 F. le tombereau d'une tonne environ et on pouvait le trier en
enlevan' les pierres qui se trouvaient dans le tout venant. On pouvait acheter
aussi du bois de mine devenu, inutilisable pour l'étaiement des galeries
En plus, des artisans qui avaient une
boutique dans la ville, il y avait des métiers ambulants qui venaient de temps
à autre pour, satisfaire les besoins des habitants.
D'abord l'estamaïré (l'étameur) qui remettait
à neuf les cuillères et les fourchettes en les plongeant dans un bain d'étain. A
cette époque, l'aluminium n'était pas encore exploité et on utilisait du papier
d'étain pour envelopper le chocolat. Je gardais précieusement ce papier au fur
et à mesure en faisant une boulette et je vendais celle-ci à l'étameur
moyennant 1 ou 2 sous, suivant sa grosseur.
Il y avait le raccommodeur de parapluies qui
remplaçait la tige, ou les baleines, ou le tissus, car un parapluie neuf coûtait
cher.
Le raccommodeur de faïence et de porcelaine
réparait les plats et assiettes cassés en fixant les morceaux entre eux au
moyen d'agrafes et de colle spéciale. Celà coûtait moins cher que de remplacer
l'ustensile cassé.
Le rémoulaïré repassait, au moyen d'une meule
en grés, actionnée par une pédale, les couteaux, les ciseaux, les hachoirs,
etc... pour un prix très modique.
Il y avait aussi des marchands ambulants de
toutes sortes: celui qui vendait des articles religieux (chapelets, médailles,
sainte vierge, etc...) le marchand d'oublies, sorte de pâtisserie très mince
roulée en forme de tuyau, le marchand de glaces, etc...
Après les vendanges, un distillateur ambulant
venait s'installer sur la place, pour brûler le vin qu'on lui apportait, afin
d'obtenir les 1000 degrés d'alcool que chaque viticulteur était en droit
d'obtenir sans payer de droit.
Au château de Cazilhac, il y avait une ferme
avec un certain nombre de vaches qui produisaient suffisamment de lait pour
toutes les familles. On voyait ainsi, tous les soirs, un âne attelé à une
petite charrette sur laquelle il y avait de nombreux bidons de lait et la
laitière le distribuait dans chaque maison suivant la quantité demandée et on
payait en fin de semaine.
Après les vendanges on procédait à la récolte
des châtaignes qui constituaient à l'époque une alimentation de base pour les
habitants des Cévennes. La meilleure façon de les conserver consistait à les déshydrater.
Pour celà, on les étalait sur un plancher à claire-voie et on maintenait en
dessous un foyer permanent pendant plusieurs jours. On obtenait ainsi des châtaignons
(castagnous en patois) que l'on faisait cuire après les avoir plongés dans
l'eau pendant quelques heures.
A l'école communale, il y avait aussi des
coutumes. D'abord en ce qui concerne l'habillement des enfants: tablier noir
pour tous, béret, chaussures montantes avec semelles à clous. Pour l'hiver
elles étaient remplacées par des galoches à semelles de bois et la pèlerine à
capuchon était nécessaire pour le froid ou la pluie.
Dans chaque classe, un élève à tour de rôle
devait allumer le poêle, une demi-heure avant la rentrée des élèves, avec du
petit bois qu'il devait apporter de sa maison.
La classe débutait chaque jour par une leçon
de morale d'après une maxime ou un proverbe écrit sur le tableau noir.
VII.
LES DISTRACTIONS et les FETES
Les jeunes gens et les adultes allaient au
café pour se distraire en jouant aux cartes ou au billard. Mon père ne manquait
pas d'y aller, le dimanche après midi, pour faire une manille avec trois autres
commerçants, en buvant l'absinthe traditionnelle.
J'étais chargé d'aller le chercher, quand l'heure du dîner approchait, et
j'avais droit à un verre de grenadine.
Le café du Pont d'Orb était surtout fréquenté
en été, car il disposait d'une grande terrasse ombragée où on pouvait jouer aux
boules et aux quilles. Le soir il y avait des séances de cinéma en plein air.
Moi, j'allais surtout au cinéma du Grand café
où on projetai les films des plus grands comiques de l'époque du cinéma muet:
Max Linder, Rigadin et tant d'autres. On voyait aussi des films de Méliès
l'inventeur du cinéma moderne, grâce à sa technique des trucages.
Les dramatiques étaient surtout des films à
épisodes qui obligeaient les spectateurs à revenir au cinéma la semaine
suivante. J'ai vu ainsi: Les mystères de New York, Les Vampires.
Il y avait des tournées théâtrales qui
passaient quelques fois pour donner une représentation d'une pièce populaire.
C'est ainsi que j'ai vu une "Jeanne d'Arc" spectaculaire qui
disparaissait, à la fin de la pièce, sur un tas de fagots de bois truffé de
feux de bengale.
Pour la fête locale, il y avait toujours un
manège de chevaux de bois qui faisait la joie des enfants de tous âges. Des
cirques miniatures venaient aussi planter leur chapiteau, sur la place de la
Mairie, au moins une fois par an.
Pendant l'été, il y avait au camp du Larzac,
sur la route de Millau, des grandes manoeuvres de l'armée par les nombreux
régiments de la région. Ceux qui étaient en garnison à Béziers, Perpignan,
Carcassonne, passaient par Le Bousquet d'Orb pour se rendre au camp.
Ils défilaient dans la ville, musique en
tête, et c'était un spectacle d'un grand intérêt pour moi, surtout lorsqu'il
s'agissait d'un régiment de cavalerie. Je rêvais souvent de défiler ainsi sur
un cheval en jouant du tambour, ce qui n'existe pas dans l'armée française de
cette époque mais que j'ai vu plus tard dans des régiments étrangers.
Pendant la belle saison, nous allions passer
la soirée du dimanche à Lamalou les Bains, station thermale située sur la rive
droite de l'Orb, à 20 Km en aval du Bousquet d'Orb. Vers 16 heures, mon père
attelait le cheval et ma mère mettait dans des paniers les victuailles pour le
dîner champêtre. Nous nous installions à la Vernière, sur les bords de l'Orb,
dans le parc de la source thermale qui donnait une eau pétillante, digestive et
agréable à boire.
Après le repas, nous allions au Casino où des
troupes de comédiens et des artistes lyriques donnaient des représentations
théâtrales, des opérettes et opéras comiques. Vers minuit, nous rentrions chez nous, au petit trot du
cheval qui mettait une bonne heure pour faire le trajet du retour. Ma mère me
prenait dans ses bras et j'étais vite endormi.
Il Y avait au Bousquet d'Orb une fanfare très
réputée qui donnait des concerts le dimanche après-midi, soit en ville aux
quatre chemins, soit dans les communes des environs. Elle participait aux
différentes fêtes, notamment celle du 14 Juillet qui commençait la veille par
une retraite aux flambeaux suivie par la majeure partie des habitants. Le
lendemain, il y avait grand bal en plein air qui se terminait tard dans la
nuit.
Tout jeune, je faisais partie de cette
fanfare où je jouais du tambour jusqu'à l'âge de 10 ans. En 1919, à ma sortie
de l'école professionnelle de Mende, j'ai repris ma place à la fanfare en
apprenant à jouer du saxophone. Mon départ pour Albi, l'année suivante, a mis
fin à mon instruction musicale.
A cette époque, il y avait au Bousquet d'Orb
de nombreuses fêtes tout au long de l'année. La première était la fête
patronale qui avait lieu fin Janvier, pour la Saint Vincent, patron des
vignerons. Elle durait trois jours du samedi au lundi. Le comité des fêtes, qui
organisait les différentes manifestations faisait appel à des musiciens réputés
d'un pays voisin. Il y avait des concerts dans les cafés et dans les rues, mais
surtout deux bals qui duraient toute la nuit. Chaque garçon avait sa cavalière
qui était aussi sa bonne amie. La salle de chaque bal était décorée au moyen de
guirlandes faites avec des branches de buis, que les jeunes gens allaient
chercher dans les montagnes, et garnies de fleurs en papier exécutées par les
jeunes filles.
Le dimanche matin les membres du comité,
accompagnés de l'orchestre, passaient chez les habitants pour quêter leur
participation aux dépenses de la fête. En 1920, j'ai fait partie pour la
première foi du comité et je me souviens que j'avais amené nos cavalières à
notre jardin du Pont d'Orb pour y cueillir des violettes.
Ma cavalière s'appelait Jeanne Mathieu et je
me suis tellement dépensé que je n'ai pas dormi pendant ces trois jours. On a
dû me réveiller le mercredi matin, après 25 heures de sommeil, afin que je
puisse embrasser nos cousins qui rentraient chez eux.
Le mardi-gras donnait lieu à un défilé qui
comprenait d'abord la "danse des treilles". Les jeunes filles, en
robe claire, portaient un cerceau recouvert de feuilles de vignes et de grappes
de raisins qu'elles manoeuvraient au-dessus de leur tête tout en dansant et
chantant une chanson folklorique. Venait ensuite la "danse du buffet"
exécutée par un groupe de jeunes gens vêtus d'une chemise et d'un pantalon
blancs. Rangés en file indienne, chacun d'eux tenait avec les deux mains un
soufflet semblable à ceux qui servaient autrefois pour activer le feu de bois
dans la cheminée (en patois "oun buffet"). Ils manoeuvraient le
soufflet en dirigeant la pointe vers le derrière de celui qui le précédait. La
file se déplaçait sur une trajectoire sinueuse en inversant le sens de
circulation et en chantant (en patois)
Toutchour
mé parlou dé mas caoussas
Chamaï
mé las pétassou pas
E
buffas y al traou (bis)
De
la mèra Pétaou
Traduction : Toujours on me parle de mon pantalon
Jamais
on me le répare
Et
souffle y au trou (bis)
De
la mère Pétaou
Le cortège se terminait par le char des
cocus. Dans la charrette, traînée par un cheval, se trouvait le Président du
comité des fêtes, avec plusieurs bonbonnes de vin rouge. Au fur et à mesure que
le cortège avançait, on faisait monter dans la charrette les jeunes gens qui
s'étaient mariés depuis le dernier mardi-gras et on les obligeait à boire du
vin après avoir mis sur la tête une belle paire de cornes de vache. Les
récalcitrants étaient poursuivis jusque dans la montagne et rattrapés par les
jeunes du comité des fêtes, le tout dans la joie et la bonne humeur.
Le soir du mardi-gras il y avait un bal
masqué, ce qui m'amusait beaucoup car mon père faisait la location de travestis
et vendait des masques. Les clients venaient s'habiller dans le salon de coiffure
en Arlequin, en Pierrot ou en Paillasse. Mon père me laissait choisir le plus
beau déguisement pour enfants et j'étais très fier.
Pour la St Fulcran, qui a lieu au mois de
Mai, la majeure partie des habitants de la région se rendait à Lodève où avait
lieu la fête du Saint, ancien évêque de Lodève, mort en l'an 1006. Après la
messe célébrée dans la cathédrale, il y avait une procession dans la ville avec
les reliques du Saint. Ensuite, la plupart des participants se rendaient dans
les auberges et les cafés pour y déjeuner, alors que les autres étaient invités
chez des parents ou des amis. L'après-midi était consacré aux amusements de la
fête foraine avec tout un éventail d'attractions diverses: manèges, tirs,
loteries, etc...
A Truscas, petit village situé entre le
Bousquet et Avène les Bains, dans la haute vallée de l'Orb, un riche habitant
avait légué à la commune une certaine somme pour assurer une distribution
gratuite de pain béni à ceux qui venaient assister à la messe le jour de
l'Ascension. Tous les ans, une nombreuse assistance venait profiter de cette
généreuse distribution de miches de pain d'une livre. La cérémonie était suivie
d'un pîque-nîque général dans les prairies qui bordent la rivière et la gaîté
était de rigueur.
Pour la Saint Jean, dès la nuit tombée, on
allumait des grands feux un peu partout avec des sarments de vigne et, dans
l'euphorie du nouvel été, on sautait dans les flammes. Le plus grand de tous
ces feux était sur la place de la Mairie, mais il était réservé aux adultes admirés
par une foule nombreuse.
Pour le 15 Août, un grand nombre d'habitants
de Lunas et des communes voisines se rendaient à Notre Dame de Nize, située
dans une petite vallée au nord-est de Lunas. On assistait d'abord à la messe
dans la petite chapelle et puis c'était le repas champêtre par groupes, avec
l'omelette traditionnelle. On chantait, on racontait des histoires on riait
dans une bonne humeur amicale.
Les vendanges étaient à la fois une fête et
une période de travail intense et pénible. Chaque famille avait plusieurs
vignes et on s'aidait mutuellement pour rentrer la récolte dans les meilleures
conditions.
Un groupe de vendangeurs, appelé
"colle" comprenait 7 à 8 coupeurs (femmes et enfants), 1 videur de
paniers, 2 porteurs de comportes et 1 charretier. Chaque coupeur suivait une
'rangée de souches en respectant l'avance des autres coupeurs. Si un coupeur
oubliait une grappe, la sanction consistait à lui barbouiller le visage, par
surpris avec cette grappe. Le travail des coupeurs était très pénible car il
fallait être constamment courbé vers le sol. Dès qu'un panier était plein de
raisins, le videur venait le prendre en mettant un panier vide à la place. Le
panier était vidé dans la comporte et les raisins tassés au fur et à mesure au
moyen d'une masse en bois. Une comporte pouvait contenir 80 Kgs de raisins, en
moyenne, ce qui donnait 50 litres de vin.
Les porteurs déplaçaient les comportes
pleines vers la route au moyen de barre de bois, en apportant des comportes
vides auprès des coupeurs. Ils chargeaient la charrette qui partait alors vers
la cave où les raisins étaient vidés dans une grande cuve en bois.
A cette époque, on écrasait encore les
raisins avec les pieds. Cette opération s'appelait le "trouillage" et
c'était notre garçon coiffeur qui était chargé de ce travail. Il voulait bien
que je "trouille" à côté de lui et je prenais grand plaisir à
patauger dans ce jus qui était versé ensuite dans les grands foudres en bois
pour la fermentation. Après une dizaine de jours, on soutirait le vin et on
pressait les grappes pour en extraire le reste du vin. Le marc était distillé
pour faire de l'eau de vie.
Toutes ces opérations se passaient dans une
ambiance de gaîté et de bonne humeur. On plaisantait, on racontait des
histoires drôles et on chantait. A midi on déjeunait copieusement sur place,
lorsque la vigne était éloignée de la maison d'habitation.
Pour la Sainte Barbe, patron des mineurs, il
y avait fête chez les habitants qui avaient des parents ou amis travaillant à
la mine. Le soir il y avait grand bal.
Les fêtes de fin d'année donnaient lieu à des
réunions de parents et amis dans les familles où les tables étaient bien
garnies. La veille de Noël il y avait foule dans les cafés où on jouait au Loto
avec des lots importants: 1er prix, un cochon - 2ème prix, dindes lièvres,
faisans - 3ème prix, canards, poulets, lapins, etc.... Ensuite les habitants se
rendaient à l'église pour assister à la messe de minuit suivie du réveillon. Le
père Noël a toujours été généreux pour moi lorsque j'étais petit. En
grandissant, je faisais semblant d'y croire encore, jusqu'au jour où j'ai
trouvé dans mes souliers boueux une brosse à chaussures et une boîte de cirage!
Pour le jour de l'An, je recevais des
bonbons, des dattes et une orange, mais aussi un écu de cinq francs en argent
que me donnait ma marraine.
VIII.
MES ACCIDENTS
Lorsque mon grand père allait à la vigne il
me prenait souvent avec lui sur la voiture. En 1909 nous avions un petit cheval
noir qui s'appelait Négro. Il était un peu fougueux et, un jour, en arrivant à
la vigne il est parti brusquement dès que mon grand père est descendu de la
voiture. Je me suis cramponné au siège mais ma position n'était guère tenable,
car chaque fois qu'une roue heurtait une souche la voiture était déportée,
tantôt à gauche, tantôt à droite. Heureusement, il y avait un arbre (pêcher ou
olivier) dont le tronc est venu se coincer entre le châssis de la voiture et la
roue. Mon grand père a pu maîtriser le cheval et j'en étais quitte pour la
peur. Mais ma mère n'a plus voulu que j'aille à la vigne avec la voiture.
A cette époque, il n'y avait pas de
maternelle dans les écoles publiques, mais le Curé avait organisé une garderie
d'enfants avec l'aide bénévole d'une dame d'un certain âge. Ma mère m'y
conduisait l'après-midi afin d'être plus libre pour son travail. Un jour un
petit camarade a découvert dans le tiroir de la table de nuit de ses parents,
un révolver qui ressemblait aux pistolets d'enfants dont ses camarades étaient
pourvus. Il l'a pris et emporté à la garderie, caché dans son tablier, puis il
l'a prêté à mon cousin Albert Maurel. Celui-ci a bien vu qu'il s'agissait d'un
vrai révolver et, pour jouer avec, il a essayé d'enlever les balles. Ne pouvant
y parvenir il m'a dit: "mets toi devant moi pour me cacher et j'arrêterai
les balles avec la main", raisonnement qui paraissait logique à un enfant
de cinq ans. Le coup est parti et après avoir traversé sa main, la balle m'a
touché sur le côté droit au niveau du rein. Il s'est levé et en passant sa main
sur le visage, il était couvert de sang. On s'est précipité sur lui et on l'a
conduit à sa maison qui était toute proche. Moi, j'étais allongé par terre et
on s'est alors aperçu que j'étais blessé. Le docteur est arrivé et a cherché a
retirer la balle. Ne la trouvant pas il a demandé aux enfants de la rechercher
dans la salle et, heureusement, on l'a trouvé sous un banc; il ne restait plus
au docteur qu'à panser la plaie et au bout de quelques jours j'étais rétabli.
Comme tous les enfants remuants et
batailleurs, j'ai reçu au cours de mon enfance pas mal de coups avec plaies et
bosses. Mais une fois, à l'âge de 10 ans, j'ai été sérieusement touché. C'était
un jeudi et nous avions décidé de livrer une bataille sur la colline située
derrière l'école, en bordure du ruisseau de Rouffiac. Nous étions divis en deux
camps et le tirage au sort avait placé le notre au bas de la colline. J'étais
chargé de faire une attaque de diversion en pénétrant dans le bois et, après
avoir remonté la pente, il me fallait longer un mur sans être vu de
l'adversaire.
Malheureusement une sentinelle m'a vu et m'a
attendu au bon endroit avec une grosse pierre dans les mains. J'étais courbé
vers le sol et ne pouvais voir le danger. Le choc a été brutal, en raison du
poids de la pierre et de la hauteur de chute.
Les "brancardiers" sont arrivés
avec le drapeau blanc et comme j'étais dans le coma et couvert de sang, ils
m'ont amené chez mes parents. Ma mère, affolée a appelé le docteur qui a
constaté un traumatisme crânien, sans fracture, mais avec une plaie sur le côté
du cuir chevelu. Si la pierre était tombée en haut du crâne mon compte était
bon.
Un pari stupide a failli nous coûter la vie,
à moi et à deux de mes camarades. Nous étions convaincus que nous pourrions
nous baigner dans la rivière le jour de Pâques. Nos autres camarades
prétendaient que c'était impossible,
alors nous avons tenu le pari.
Pendant la semaine sainte, il est tombé cette
année là, des trombes d'eau sur le pays. La rivière avait tellement grossi que
les berges étaient inondées d'une eau boueuse et il y avait un fort courant. Nos
camarades nous harcelaient en disant que nous allions nous dégonfler ce qui
constituait une injure pour nous. Alors, le dimanche après Vêpres, nous avons
mis notre projet à exécution, sous le regard narquois de nos camarades qui
espéraient encore un abandon.
N'ayant pas pu prendre nos caleçons, nous
sommes entrés tou1 nus dans une eau glacée et le courant très fort a bien
failli nous emporter tous les trois. Le pari étant gagné nous sommes sortis
tout fiers de cette aventure. Moi je m'en suis tiré avec une bonne fessée par
ma mère, mon cousin Jules Bonhiomme était couché le lendemain avec une jaunisse
et mon autre camarade, Marcel Combes était atteint d'une broncho-pneumonie. Par
la suite sa santé s'est détériorée et il est mort à 25 ans de la tuberculose.
Le 31 Juillet 1916, j'ai quitté l'école
communale, après avoir passé mon certificat d'études. Le lendemain, premier
jour des vacances, nous avions convenu avec un camarade qui habitait à la
gendarmerie, d'aller à Lunas en vélo pour assister à la confirmation. J'étais
impatient de partir et, ne le voyant pas arriver à l'heure prévue, je suis
allée à sa rencontre. Dans le bas de la descente j'allais à vive allure
lorsque, tout à coup, une vieille dame est sortie de l'église. Etant sourde,
elle n'a pas entendu ma sonnette et j'ai essayé de passer derrière elle. A ce
moment, elle m'a aperçu et elle a fait demi tour. Le choc étant inévitable, je
me suis trouvé sur la chaussée avec le vélo et la vieille dame sur moi. Mon
père alerté par des voisins est venu me chercher et le docteur, appelé
aussitôt, a constaté une fracture du tibia de la jambe gauche. Je suis resté
couché pendant un mois avec ma jambe plâtrée et mes camarades venaient à tour
de rôle me tenir compagnie. Ensuite j'ai marché à l'aide de béquilles, puis d'une
canne pendant deux mois.
Drôles de vacances!
IX.
LA GUERRE de 1914-1918
Le 1er Août 1914, nous étions en train de
nous baigner, mes camarades et moi, près du pont de chemin de fer. Tout à coup,
nous entendions des sonneries de clairons et de tambours qui semblaient
provenir de la place, de la Mairie. Vite habillés, nous courûmes vers cette
place où un défilé commençait à se former. Nous apprîmes que la mobilisation
générale venait d'être annoncée et nous prîmes place dans le cortège qui
parcourut les rues de la ville et des hameaux voisins.
Le lendemain, toute la population était à la
gare pour accompagner la majeure partie des hommes de 21 à 45 ans qui, par des
trains spéciaux, devaient se rendre dans leur centre de mobilisation. Sur les
wagons on pouvait voir des inscriptions à la craie telles que: "à Berlin
dans 8 jours", "mort aux boches", etc.... Les hommes chantaient
des refrains patriotes, mais les femmes pleuraient. A cette date, mon frère était
sur le point de terminer ses deux ans de service militaire; il n'était donc pas
parmi les partants. Par contre, notre garçon coiffeur, Edouard Villard, était
mobilisé et mes parents l'accompagnaient à la gare. Mon père n'était pas
mobilisable, ayant dépassé la limite d'âge de la 1ère réserve, mais il fut
réquisitionné dans la garde civile.
Très vite les premiers trains de blessés
passèrent en gare à destination des hôpitaux de la région. Pendant l'arrêt, les
habitants distribuaient des bouteilles de vin et des gâteaux aux blessés qui
portaient encore l'uniforme à pantalon rouge, véritable cible pour l'ennemi.
Plus tard, les soldats furent vêtus de "bleu horizon" et le nombre de
blessés diminua, d'autant plus que le front s'était stabilisé et que les deux
armées s'étaient installées dans les tranchées.
La population participait à la guerre sous
différentes formes. Le soir on faisait de la charpie, avec des draps usés, qui
servait à faire des pansements. On faisait aussi des colis pour les
prisonniers. Sur l'appel du gouvernement les habitants portaient leurs pièces
d'or au percepteur, contre des billets de banque et remise d'un certificat de
civisme.
En 1915, les premiers permissionnaires
arrivèrent et ils furent choyés dans leur propre famille et dans celles des
autres mobilisés. Au café, les consommateurs les entouraient pour écouter des
récits de batailles. Mais il y avait les familles qui recevaient l'avis de
décès de leur enfant ou même du chef de famille. Leurs noms au nombre de 66
figurent sur le monument aux morts.
Mon frère ne courait aucun risque, ayant
conservé l'emploi de télégraphiste, à la Préfecture maritime de Toulon, qu'il
occupait pendant son service militaire. De plus, étant fonctionnaire, il a
perçu son traitement pendant toute la durée de la guerre, ce qui lui permettait
d'avoir une chambre en ville. Mais cette liberté l'a conduit aux jeux et aux
femmes, ce qui a altéré sa santé et son caractère. Ses fiançailles qui avaient
été célébrées avant la guerre avec une jeune fille de bonne famille, ont été
rompues.
Dès les premiers jours de la guerre, les
activités festivales de la commune furent suspendues et celà jusqu'à
l'armistice. Plus de fanfare, de fête patronale, de bals. Plus de troupes de
passage, ni de cirques. Nous avions un phonographe avec de nombreux disques et
le tout fut monté au grenier avec défense d'y toucher. Dans le pays il y avait
une atmosphère de peur et d'angoisse.
On voyait des espions partout; la nuit on gardait
les ponts et la poudrière de la mine. Certains prétendaient que, derrière les
panneaux publicitaires du "Bouillon Kub", il y avait le plan la ville
avec indication des lieux vulnérables. Le Maire fit enlever ces panneaux, pour
calmer la population, mais il n'y avait rien derrière!
Sur les murs, à l'intérieur des locaux
publics et dans les wagons de chemin de fer, il y avait des affiches portant
l'inscription :
Taisez-vous, Méfiez-vous,
Les oreilles ennemies vous écoutent.
Le 11 Novembre 1918, l'armistice qui mettait
fin à la guerre était signé et une joie indescriptible se manifesta parmi les
habitants. A l'école, on nous avait accordé quelques jours de congé, afin que
les élèves puissent se joindre aux réjouissances familiales. Avec plusieurs
copains, nous nous sommes réunis pour fêter cet heureux évènement et chacun
avait apporté une bonne bouteille prélevée dans les réserves paternelles. Nous
avons bu copieusement et la cuite qui en est résultée me laisse encore un
mauvais souvenir, tellement j'ai été malade pendant la nuit qui a suivi cette
beuverie.
X.
MES ETUDES
Mon père aurait bien voulu que j'apprenne le
métier de coiffeur, afin que je puisse assurer le maintien dans la famille, du
magasin qu'il avait créé. C'est ainsi que, dès mon jeune âge, j'ai commencé à
savonner les clients qui venaient se faire raser et, comme j'étais trop petit,
on m'avait confectionné un petit banc.
Le dimanche je tachais de me soustraire le
plus possible à ce travail, afin de pouvoir jouer avec mes camarades. De toute
façon ce métier ne me plaisait guère et je m'arrangeais pour saboter mon
ouvrage. Un jour j'ai mis le blaireau dans la bouche d'un client qui, à mon
avis, parlait trop. Un jeudi après-midi, mon père m'a demandé de garder le
magasin pendant qu'il allait à la pêche. Mes camarades sont venus me tenir
compagnie et nous étions en train de jouer lorsqu'un petit garçon est venu pour
se faire couper les cheveux. Histoire de rigoler et d'épater mes copains j'ai
donné un coup de tondeuse du cou jusqu'au front et ensuite d'une oreille à
l'autre. De sorte que l'enfant avait une belle croix sur la tête lorsqu'il est
rentré chez lui. Sa mère est venue faire du scandale au magasin, mon père a
réparé ce mauvais travail, mais il a compris que je n'avais pas les
dispositions voulues pour faire ce métier. Mes parents ont alors décidé de
vendre le fonds de coiffeur en 1918 et de me faire poursuivre mes études au
collège de Millau, comme pour mon frère.
A cause de mon accident relaté plus haut, je
suis rentré au collège avec un mois de retard et, compte tenu de mon âge
avancé, mon père avait demandé que je saute la 6ème. Aussi, j'ai eu bien du mal
à me faire des camarades et, au début, j'ai souffert de cet isolement. Lorsque
j'écrivais à mes parents, les larmes tombaient sur la lettre et tachaient mon
écriture. Commencer l'enseignement secondaire en 5ème était une erreur et
j'avais du mal à m'y adapter. La nourriture étant mauvaise et insuffisante, je
réussis à convaincre mes parents pour qu'ils me changent d'école.
Mon cousin Albert Maurel, dont la blessure de
sa main n'avait laissé aucune trace, faisait ses études à Mende (Lozère) à
l'Ecole Pratique de Commerce et d'Industrie. Mes parents ont accepté de m'y
envoyer afin de préparer le concours d'entrée aux Arts & Métiers. Là,
aussi, j'ai sauté une classe mais comme j'avais des dispositions pour
l'enseignement technique, j'ai eu vite fait de rattraper mes camarades.
Mende est situé en plein massif central, dans
à 730 mètres d'altitude. Il y fait très froid l'hiver et neige de novembre à
fin mars. Le dortoir, qui comprenait n'était pas chauffé et le plus souvent les
canalisations étaient gelées. Dans ce cas nous faisions notre toilette y avait
un robinet protégé de la gelée.
La nourriture n'était pas bonne et nettement
insuffisante pour notre appétit. Le matin un bouillon dans lequel trempait un
peu de pain. A midi, un petit morceau de viande avalé en trois bouchées et
remplacé le vendredi par une sardine, haricots secs ou pommes de terre comme
légumes. Le dîner comportait une soupe et un légume. Un jour, pour protester
contre ces portions réduites, mon cousin et moi avons mangé un plat de haricots
destiné à toute la table, soit dix portions, ce qui nous a valu une bonne'
correction du Directeur.
Le pain étant rationné, on nous le donnait
moisi afin d'en manger moins. Heureusement, nous avions tous des provisions
envoyées par nos parents: confiture, chocolat, fromage et nous pouvions faire
porter du pain par les externes. De sorte que notre meilleur repas était le
goûter de quatre heures.
Nous étions plusieurs camarades de l'Hérault
et nous formions un groupe de chahuteurs et de bagarreurs. Au dortoir on
mettait les lits en portefeuille, la nuit on renversait les lits avec
l'occupant, on faisait du bruit pour réveiller le surveillant. En récréation,
on attrapait un bleu pour le baptiser et, après avoir défait sa braguette, on
remplissait sa culotte de neige et on la refermait. A l'étude on faisait
enrager le surveillant par toutes sortes d'inventions: caoutchouc dans le poêle
ou chiffons dans le tuyau, insectes bruyants ramenés de la promenade, etc. Mon
cousin Albert et moi, nous avons eu un jour une idée de sabotage qui a atteint
un but dépassant nos prévisions. Nous avons enlevé les lampes électriques de la
salle d'études, puis nous avons introduit des rondelles de papier dans les
douilles et avons replacé les lampes. Lorsque le surveillant a voulu allumer
les lampes, il n'y avait pas de lumière. Il a appelé le Directeur de l'école
qui, après avoir vérifié que les fusibles étaient intacts, a fait appel à un
électricien. Celui-ci a pensé qu'il s'agissait d'un mauvais contact dans les
raccords des fils électriques. Il a commencé par démonter les baguettes et au
bout d'une heure toute l'installation était mise à nue. Les fils pendaient sur
tous les murs et toujours pas de lumière. C'est alors qu'il a eu l'idée de
vérifier les douilles, chose qui était impensable puisque plusieurs douilles ne
peuvent pas se détériorer en même temps. Quand il a aperçu la rondelle de
papier il a compris l'origine de la panne. Le Directeur s'est mis en colère, nous
a traité de tous les qualificatifs et il a exigé que les coupables se
dénoncent. Comme nous n'avions pas eu de témoins pendant notre mauvaise action,
nous sommes restés muets, la sanction aurait été trop lourde.
Notre surveillant était petit et gros et on
l'appelait "plein de soupe". Lorsqu'il nous conduisait à la
promenade, le dimanche, il avait tendance à s'endormir pendant que nous
jouions. D'où l'idée de lui faire une blague lorsque, ayant remarqué que
l'heure du retour était arrivée, notre "plein de soupe" dormant
toujours, nous nous sommes mis en rangs et avons regagné rapidement l'école
sans lui. Arrivés dans la cour, nous sommes restés bien alignés et le Directeur
qui assistait toujours de sa fenêtre au retour de promenade, a constaté l'absence
du surveillant. Descendu dans la cour, il nous demandait une explication,
lorsque le surveillant a fait son apparition tout essoufflé. Il s'est
embrouillé dans toutes sortes d'explications, car il ne pouvait pas dire qu'il
s'était endormi. Il a donc été sévèrement admonesté par le Directeur.
En classe, j'étais très attentif aux leçons
des professeurs et j'avais de bonne notes aux compositions. J'étais très fort
en "math" et un des premiers en dessin et à l'atelier. Aussi, le
Directeur a écrit à mes parents pour leur signaler que j'étais capable de me
présenter au concours d'entrée aux Arts & Métiers.
Malheureusement pour moi, mes parents
n'étaient plus en mesure de payer mes frais de pension et de scolarité, pour
les raisons indiquées plus haut. Mon père a donc répondu négativement à la
proposition du Directeur et demandé ma sortie de l'école. J'ai passé l'examen
de fin d'études industrielle et, classé deuxième, j'ai obtenu le diplôme
d'ajusteur dessinateur qui correspondait alors au C.A.P. d'aujourd'hui.
J'ai quitté l'école le 31 Juillet 1919, à
l'âge de 15 ans, alors qu'on venait de signer le traité de paix de Versailles
qui mettait fin à la guerre de 1914-1918.
Mes parents ont fait de grands sacrifices
pour me permettre de faire des études, car à cette époque il fallait tout payer
et, chaque trimestre, mes parents devaient envoyer une forte somme. C'est grâce
à ces études que j'ai pu me faire une bonne situation.
XI.
MON ENTREE DANS LA VIE PROFESSIONNELLE
Avec mon diplôme, le Directeur de l'Ecole
Pratique de Mende, m'avait remis une lettre d'introduction pour un emploi de
dessinateur à la Sté des Automobiles Chenard et Walcker de Gennevilliers. Le
chef du bureau d'études de cette Société avait préparé les Arts & Métiers
dans cette école et il recrutait ainsi son personnel parmi les meilleurs
élèves. J'étais donc fier en arrivant chez mes parents de leur montrer cette
lettre, car la construction automobile m'intéressait beaucoup. Mais ma mère a
levé les bras au ciel en me traitant de fou! "Aller te perdre à Paris à
ton âge, tu n'y penses pas ?" Malgré mes supplications il n'y a pas eu
moyen de leur faire changer d'avis.
Mon parrain, qui était contremaître à l'atelier
de réparation, à la Verrerie, a proposé à mes parents de me prendre avec lui et
ma mère a sauté sur l'occasion. Mon frère étant parti à Pont à Mousson, elle
tenait à garder son dernier fils auprès d'elle.
C'est ainsi que j'ai débuté à la Verrerie le
8 Octobre 1919, en qualité d'ajusteur, avec un salaire de 11 Francs par jour.
Le travail consistait à réparer les moules qui servaient à la fabrication des
bouteilles Après quelques semaines j'étais aussi capable que les autres
ouvriers qui faisaient ce travail depuis plusieurs années. Je n'avais aucune
possibilité d'avancement avant le départ en retraite de mon parrain qui était
encore relativement jeune. J'ai fait comprendre à mes parents que cet emploi
était bien au-dessous de ma formation professionnelle. Mon père a fait appel à
ses relations et un ami d'enfance, qui était entrepreneur de travaux publics à Albi
(Tarn), a consenti à me prendre à son service en qualité de dessinateur.
J'ai pris ce nouvel emploi à compter du 1er
Août 1920 et ma mère m'a accompagné pour me trouver une chambre chez des
particuliers. Mon salaire était de 350 F. par mois, ce qui était largement
suffisant pour faire face à mes dépenses. Je payais ma chambre 20 F. par mois
et ma pension au restaurant 6 F. par jour pour les trois repas. Il me restait
donc 150 F. pour m'habiller et me distraire. Mon premier complet sur mesures m'a
coûté 45 F. Le cinéma coûtait 1,50 F. et le théâtre 2,60 F. Un café 20 centimes
et l'apéritif 50 centimes. Je faisais des économies sans me priver.
Le travail me plaisait beaucoup. L'entreprise
était spécialisée dans la construction des usines à chaux ou à ciment. Le chef
du bureau d'études me donnait à faire les dessins des ouvrages métalliques:
charpentes distributeurs de trémies, réservoirs d'eau, etc....
Il y avait deux chantiers en cours et
plusieurs projets pour lesquels les demandeurs cherchaient à se procurer le
financement. Malheureusement, la crise économique qui est survenue à cette
époque a stoppé les investissements et, faute de travail, mon patron a dû
procéder à des licenciements. Comme j'étais le dernier rentré, j'ai fait partie
de la première fournée.
C'est dommage, parce que je m'étais bien
adapté au travail, à mon indépendance et à cette vie agréable pour un jeune
homme de seize ans. Albi était une ville calme, plutôt bourgeoise, où les
distractions ne manquaient pas: pièces de théâtre, chanteurs, cirques de
passage, bals, concerts publics le dimanche. J'avais emporté mon vélo, ce qui
me permettait de faire des ballades dans les environs.
J'ai bien cherché à me recaser dans les
autres entreprises de la ville, mais la crise touchait tous les secteurs et
j'ai dû retourner chez mes parents pour attendre des jours meilleurs. Je suis
arrivé au Bousquet d'Orb le 30 Avril 1921.
Tous les jours je regardais les offres
d'emploi dans les journaux mais, dans ce pays où la viticulture constitue le principal
moyen d'existence, il m'était difficile de trouver un emploi de dessinateur
industriel.
XII.
FIN DE MA JEUNESSE
Mon frère, qui était dans les P.T.T. à Pont à
Mousson venait d'obtenir sa mutation à Paris et, après s'être marié, il est
venu au Bousquet d'Orb pour présenter sa femme
à mes parents. Il leur a proposé de m'amener à Paris, pour essayer de
trouver une situation, étant entendu qu'il s'occuperait de moi et me
surveillerait. Alors, ma mère a consenti à mon départ qui a eu lieu fin Mai
1921.
J'ai été émerveillé par les splendeurs et les
plaisirs de la capitale et j'étais bien décidé à y rester. Mais pour celà il me
fallait trouver une situation stable. Le matin je me levais à cinq heures et je
consultais les petites annonces des journaux. Je choisissais l'offre d'emploi
qui correspondait le mieux à ma qualification et me rendais aussitôt à
l'adresse indiquée. Lorsqu'on appelait le premier arrivé, nous étions déjà une
quarantaine à solliciter la place. Il y avait des chômeurs de tous âges et certains
étaient père de famille. Après une dizaine d'appelés, on nous signalait qu'il
était inutile d'attendre. Je recommençais l'après-midi, avec les journaux du soir,
sans résultat. Et celà a duré pendant trois semaines.
J'ai compris alors qu'il me serait difficile
de m'intégrer dans cette grande ville, où l'individu n'est plus martre de son
destin. Mais il n’était pas question de retourner dans mon pays natal pour faire
le métier de mon père ou rentrer à nouveau à la Verrerie. De toute façon ma
jeunesse était bien terminée et la situation devenait sérieuse.
Je consultais le plus de journaux possible
(il n'y avait pas de bureaux de placement à l'époque) et je constatais qu'il y
avait des offres d'emploi assez nombreuses dans le commerce. Mon frère m'a
conseillé d'accepter n'importe quel emploi pour débuter et, c'est ainsi que je
suis entré le 24 Juin 1921 dans une maison, qui faisait l'exportation de
soieries vers l'Angleterre, comme employé aux écritures. Je gagnais 275 F. par
mois, ce qui était juste suffisant pour ma nourriture étant logé gratuitement
chez mon frère. Cette maison a fait faillite et le 30 Février 1922 je me
trouvais à nouveau sans emploi. Mais pendant ces quelques mois j'avais appris
des notions de comptabilité et grâce au certificat qu'on m'avait remis, j'ai pu
trouver rapidement une place d'aide comptable à 450 F. par mois.
C'était à Levallois, dans une carrosserie
automobile réputée qui travaillait surtout pour une riche clientèle. Celle-ci
se faisait de plus en plus rare, en raison de la crise économique, la Direction
a alors décidé de faire des carrosseries en série pour la firme Delahaye. Mais
le chef de fabrication a commis des erreurs dans son calcul du prix de revient.
D'où un déficit d'exploitation qui s'aggravait de plus en plus, au fur et à
mesure de l'exécution d'un contrat gui ne pouvait être résilié. La faillite
était alors inévitable et la plupart du personnel a cherché du travail
ailleurs. Lorsque la faillite a été déclarée, en Décembre 1922, j'étais seul
dans les bureaux avec la téléphoniste. Le Syndic m'a demandé de rester à mon
poste jusqu'à ce que les carrosseries en cours de montage soient terminées, en
me promettant de me trouver un nouvel emploi.
Tous les jours il me fallait embaucher de
nouveaux ouvriers pour remplacer ceux qui partaient (tôliers, menuisiers,
peintres, garnisseurs, etc...) Il me fallait assurer la paye, acheter les
fournitures qui manquaient. Mettre la comptabilité à jour. En somme, faire le
travail d'un petit patron et je n'avais que 18 ans.
Le Syndic m'a proposé un emploi chez un de
ses confrères, avec un salaire de 500 F. par mois. J'ai accepté et, en quelques
mois, je suis devenu second clerc à 700 F. par mois, le salaire doublé en fin
d'année et un mois de vacances. A mon âge une telle situation était inespérée,
puisque le principal clerc, qui avait plus de 40 ans, gagnait 900 F. Mais le
travail ne me plaisait pas, à cause du contact permanent avec des commerçants
ou industriels qui avaient fait faillite.
A la fin de l'année 1923, j'ai aperçu une affiche
annonçant l'ouverture d'un concours pour le recrutement de dessinateurs dans
les services techniques de la Ville de Paris. Je connaissais toutes les
matières du programme, sauf le dessin de travaux publics (à l'école je n'avais
appris que le dessin de mécanique).
J'ai pris des leçons à l'école spéciale de
travaux publics et je me suis fait inscrire, sans grand espoir. Les épreuves
écrites ont eu lieu le 25 Mars 1924, dans la grande salle du gymnase de l'Avenue
Jean Jaurès. Nous étions 1200 candidats pour 100 places, avec chacun une petite
table, et je me sentais perdu au milieu de cette immensité. Néanmoins, je me
tirais pas trop mal des épreuves et quelques semaines après j'étais convoqué
pour passer l'oral. J'ai été stupéfait en apprenant le résultat définitif: 35ème sur 1200 !
C'est ainsi que j'ai débuté le 1er Octobre
1924 à la Direction des Eaux de Paris, en qualité de Commis Dessinateur avec un
salaire global de 540 F. par mois, mais qui est monté rapidement au delà des
700 F. que j'avais auparavant. De toute façon, mon avenir était assuré avec
possibilité d'accession à des emplois supérieurs.
En 1929, je me suis présenté au concours de
Conducteur de Travaux, limité à 35 places, après avoir suivi des cours par
correspondance et assisté aux cours du soir. J'ai été reçu 15ème sur 450 candidats
et nommé à ce grade le 16 Juillet 1929.
Le 1er Octobre 1942, j'ai été nommé Ingénieur
des travaux de Paris.
Nommé Chevalier du mérite agricole par arrêté
ministériel du 15 Février 1954.
Nommé Officier d'académie par arrêté du
Ministre de l'Education Nationale en date du 10 Décembre 1955.
Enfin, j'ai été nommé Ingénieur Divisionnaire
des travaux de Paris, à compter du 1er Janvier 1962.
J'ai pris ma retraite le 1er Juillet 1965,
après 41 années des services à la Direction des Eaux de Paris où j'étais chargé
depuis 1931, de tout ce qui concerne la vente de l'eau (branchements, compteurs,
facturation, encaissements, réclamations, etc....).
Aucun des emplois que j'ai occupés avant mon
entrée à la Ville de Paris n'aurait pu me conduire à une situation aussi
importante. A la fin de ma vie, je suis heureux d'avoir donné à mes deux
enfants les moyens d'obtenir une bonne situation et de savoir que la continuité
de la famille Commeignes sera assurée par les huit descendants masculin de mon
grand père.
Aix les Bains, le 29 Janvier 1979
ANECDOTES
Les personnes âgées, qui vivaient à Lodève à
l'époque de mon enfance, racontaient un évènement qui s'était passé en 1745,
lors de la crue dévastatrice. Deux amis étaient en train de bavarder sur le
sommet du vieux pont en dos d'âne qui se trouvait sur la Lergue à l'emplacement
du pont Vinas actuel. Au loin, vers le Nord, le ciel était tout noir et l'orage
grondait. Tout à coup, on vit la rivière grossir rapidement et un flot énorme
s'avancer vers le pont. Des passants, qui étaient sur le quai, alertèrent nos
deux amis qui se séparèrent aussitôt en disant (en patois),
- Adiou Berdel
- Adiou Coummeignès
Et le flot emporta le pont et les deux amis.
Cette histoire prouve qu'il y avait déjà des Commeignes à Lodève, au début du
XVIIIe siècle.
D'ailleurs, un historien a découvert dans des
archives de la mairie de Lunas qu'en 1793, on avait établi des bases pour la
contribution foncière des terres et des immeubles. "Des erreurs ayant été relevées,
il fut nécessaire d'avoir recours aux
bons offices du citoyen Commeignes, greffier de la municipalité de Neffiés qui
avait travaillé pour le District de Lodève en qualité de calculateur pour la
contribution foncière".
○
○ ○
○
Lorsque mon père et M. Carrel partaient en
tournée pour vendre de l'huile d'olive' il leur arrivait de s'arrêter dans des
hôtels anciens et sans confort. Un soir, ils étaient couchés dans la même
chambre et, à la lumière d'une bougie, ils faisaient le bilan des commandes de
la journée. Un bruit insolite éveilla leur attention et mon père vit un gros
rat disparaître dans un trou de plancher. Il se leva, prit la bougie de la main
gauche, son soulier de la main droite et se dirigea vers le trou. En se
baissant, le pompon de son bonnet de nuit vint frôler la flamme de la bougie et
aussitôt une lueur éclaira toute la chambre. Mon père, qui ne voyait pas que le
feu était au-dessus de sa tête, cria "Au feu, au feu" ! Et M. Carrel
riait tant qu'il pouvait.
○
○ ○
○
Alors qu'ils étaient en tournée dans les
villages voisins du Bousquet d'Orb, mon père conduisit M. Carrel chez une
institutrice de forte corpulence qui venait d'être nommée dans un de ces
villages.
Après avoir goûté l'huile, elle en commanda
10 litres et, lorsque M. Carrel lui demanda à quelle adresse il fallait faire
la livraison, elle répondit "Mademoiselle Congras à Caunas". M.
Carrel ne pu s'empêcher de rire bruyamment et s'excusa aussitôt. "Je vous
comprends, dit-elle, ce sont ces messieurs de Montpellier qui m'ont fait une
sale blague en me nommant dans ce village. J'ai fait plusieurs réclamations,
mais comme on trouve celà drôle, je suis toujours là.
○
○ ○
○
La mine du Bousquet d'Orb utilisait une
grande quantité d'explosifs pour le percement des galeries d'extraction du
charbon. Ces explosifs étaient stockés dans une poudrière, bâtiment massif,
situé sur le chemin du Rouffiac, à quelques centaines de mètres de
l'agglomération. Il y avait un gardien qui était logé à part, dans un pavillon,
avec sa femme et ses deux enfants. Un jour, on vit arriver sa femme en courant,
le visage couvert de sang. Son mari, dans une crise de folie, venait de la
chasser à coups de fusil. On appela les gendarmes qui montèrent à la poudrière
pour maîtriser le forcené. Celui-ci s'était barricadé et il menaçait de faire
sauter la poudrière si on approchait. Toute la population était en émoi, car il
y avait suffisamment d'explosifs pour faire sauter toute l'agglomération. Les
gendarmes essuyèrent quelques coups de fusil et devant une telle résistance,
ils firent semblant de se retirer. Un habitant, qui connaissait bien la
montagne située derrière la poudrière, fit un grand détour pour pénétrer dans
la cour qui séparait le pavillon d'habitation de la poudrière. Il coupa le
cordon bick-ford, qui était destiné à faire sauter les explosifs, et tira
plusieurs coups de fusil pour détourner l'attention du gardien. Les gendarmes
passèrent aussitôt à l'action en pénétrant dans la maison où ils réussirent à
le maîtriser Il termina ses jours à l'asile d'aliénés d'Aniane près de
Montpellier.
○
○ ○
○
Mon père était un grand pêcheur et, par
contre, il n'aimait pas la chasse. Il se
contentait de vendre des fusils et des munitions à ses clients. Ayant reçu un
nouveau modèle de fusil, très précis, il en fit tellement d'éloges que les
chasseurs l'invitèrent à la battue aux sangliers prévue pour le dimanche
suivant. "Je te placerai à un endroit où le sanglier est obligé de passer,
dit un des chasseurs, avec ton fusil tu ne pourras pas le manquer". Pris
au mot, mon père ne pouvait pas refuser.
Le groupe des chasseurs et la meute des
chiens partirent au petit jour et mon père se mit en poste à l'emplacement qui
lui avait été réservé. C’était au bord d'un sentier où le sanglier devait
déboucher à une vingtaine de mètres.
Pendant que les autres chasseurs rabattaient
le gibier, avec les chiens, mon père raisonnait autrement que dans son magasin.
Le fusil n'était peut être pas aussi précis qu'il espérait! Si le sanglier
était seulement blessé, il pourrait se jeter sur lui. Autant de raisons pour se
mettre à l'abri. Voyant un bel arbre à proximité, mon père y monta et bien
installé entre deux maîtresses branches, il attendit les évènements. Tout à
coup, les aboiements des chiens se rapprochèrent, les appels des chasseurs se
firent entendre et des coups de fusils claquèrent. Mon père s'attendait à voir
le sanglier dans la ligne de mire de son fusil' mais se furent les chasseurs
qui venaient lui, annoncer la mort de la bête. Les plaisanteries et les
quolibets s'abattirent sur mon père et il jura, mais un peu tard, qu'on ne le
reprendrait plus.
○
○ ○
○
Mon oncle Ernest, qu'on appelait Bosco comme
mon père, était à la fois bon chasseur et bon pêcheur mais les moyens qu'il
employait n'étaient pas toujours réglementaires. C'était la bête noire des
gendarmes qui couraient souvent après lui sans pouvoir le prendre en flagrant
délit. Cependant, un jour, il se fit prendre en train d'attirer les oiseaux en
imitant leurs cris. Il fut convoqué au tribunal de Lodève sous l'inculpation de
"chasse aux oiseaux au moyen d'appeaux" Les appeaux étaient des
sortes de sifflets qui permettaient d'imiter les cris de certains oiseaux. Mon
oncle fit remarquer au Président du Tribunal qu'il imitait lui-même les cris
d'oiseaux sans se servir d'appeaux. Le Président le mit à l'épreuve et mon
oncle imita si bien les cris des perdreaux, cailles, et alouettes, que le
Tribunal estima l'absence d'infraction à la loi, qui interdisait seulement
l'usage des appeaux. Mon oncle fut acquitté, à la stupéfaction des gendarmes et
à la satisfaction du public qui assistait à l'audience du Tribunal.
○
○ ○
○
Lorsqu'on avait besoin d'un lièvre, d'un
lapin, ou d'un plat de truites pour un repas de cérémonie, on faisait appel à
"Bosco" qui était connu de tous les habitants de Lunas et des
environs. Il exerçai le métier de coiffeur, mais souvent absent lorsqu'un
client se présentait pour la barbe ou la coupe des cheveux. Sa femme avait
d'ailleurs appris le métier pour pouvoir le remplacer en cas de besoin
En outre, il n'apportait pas toujours dans
son métier le soin nécessaire pour satisfaire ses clients. C'est ainsi qu'une
fois, il était en train d'en raser un et la barbe était à moitié rasée,
lorsqu'un chasseur vint lui rapporter un chien nommé "Trissou" que
mon oncle lui avait vendu et qui n'avait aucune des qualités d'un chien de
chasse. Une longue discussion s'engagea, mon oncle persistant à vanter la
valeur de ce chien, lorsqu'un autre client entra et demanda à mon oncle s'il
avait un chien "truffier" à vendre. C'était une belle occasion pour
conclure la discussion avec le chasseur et ce nouveau client se décida à
acheter "Trissou" dont mon oncle venait de vanter tous les mérites
pour la recherche des truffes. Après une heure d'attente, le premier client fut
enfin rasé.
○
○ ○
○
En plus du métier de coiffeur, mon oncle
faisait aussi du commerce. Il vendait des motos d'occasion, des chiens, des
appareils d'éclairage pour les fermes, dés vélos, des fusils de chasse, etc...
Mais pour écouler plus facilement sa
marchandise il la cédait avec des facilités de paiement et, comme il n'avait
pas d'ordre, il oubliait souvent de se faire payer. De sorte que son commerce
était déficitaire, au grand désespoir de sa femme qui manquait toujours
d'argent pour faire vivre la famille.
Mon père l'avait pris comme associé pour
faire le cinéma ambulant dans les communes des environs. Mon oncle était
surtout chargé de faire rire les spectateurs pendant la projection des films
muets de l'époque. IL parlait sans cesse et commentait d'une façon humoristique
les situations qui se déroulaient sur l'écran. C'est ainsi qu'il mettait la
main sur l'objectif de l'appareil en disant "Je vous cache cette scène
parce qu'elle est trop triste" et il décrivait ce qui se passait (agonie
d'un malade, enterrement, etc....). C'est lui qui faisait la quête à l'entracte
car il avait le don de faire sortir le porte monnaie de la poche des
spectateurs ravis.
○
○ ○
○
Mon oncle Ernest avait un caractère
aventureux et il avait toujours des solutions originales pour se tirer d'un
mauvais pas.
Circulant en vélo en pleine nuit et sans
éclairage, il fut arrêté par les gendarmes qui s'apprêtaient à lui dresser
procès-verbal. Il leur expliqua que sa lanterne acétylène venait de s'éteindre
parce qu'il n'y avait plus d'eau dans le réservoir. Comme les gendarmes
restaient incrédules sur cette explication il eut une idée géniale. Il leur dit
"si vous le permettez je vais vous montrer que j'ai dit la vérité".
Il se retourna fit pipi dans le réservoir et demanda une allumette aux
gendarmes. Comme il restait un peu de carbure dans la lanterne, celle-ci
s'éclaira aussitôt et les gendarmes renoncèrent à dresser le procès-verbal.
Sa belle-fille et la mère de celle-ci
s'apprêtaient à prendre le train un jour d'hiver pour aller à Montpellier, lorsqu’elles
le rencontrèrent. Cà tombe bien, dit mon oncle, je vais justement à Montpellier
faire réparer l'éclairage de ma voiture et je vous ramènerai dans la soirée. Le
voyage s'effectua sans difficulté, mais le soir lorsqu'il retrouva ses deux
voyageuses, il leur dit qu’on n’avait pas pu réparer son éclairage, mais qu'il
connaissait bien la route et que tout irait bien. Jusqu'à Lodève ils eurent un
beau clair de lune, mais à partir de là et, notamment dans la montée de la
baraque de Bral, il y avait un brouillard intense et, comme cette route
comporte de nombreux virages au-dessus de précipices, la poursuite du voyage
paraissait impossible. C'est alors que mon oncle eut une idée originale. Il
avait dans le coffre de sa voiture une vieille lanterne de fiacre. Il alluma
cette lanterne, la donna à sa belle fille en lui disant "tu marches en
restant au milieu de la route et je suivrai avec la voiture en étant guidé par
la lumière de la lanterne. Ainsi fut fait et ils arrivèrent après plus d'une
heure au sommet de la côte. Sur l'autre versant le ciel était dégagé et le voyage pu ainsi se
terminer, mais ses compagnes eurent bien peur.
Alors qu'il revenait en voiture de Béziers,
avec sa femme, il fut surpris par la nuit. Pas possible d'allumer les phares
car, utilisant le plus souvent des vieilles voitures, l'éclairage ne
fonctionnait pas (panne de dynamo vraisemblablement). A cette époque les routes
n'étaient pas goudronnées et elles paraissaient blanches dans la nuit. Avec un
ciel étoilé on pouvait rouler sans éclairage, mais entre Faugères et Bédarieux
la route passe dans un tunnel situé sous le col du Buis. Sa femme ne voulait
rien savoir pour franchir cette difficulté sans éclairage, l'accident étant
certain. Il arrêta sa voiture et lui expliqua la marche à suivre: "tu
tends ton bras droit à travers la portière et quand tu touchera le mur tu
criera, j'obliquerai vers la gauche. Moi, je tendrai le bras gauche et si je
touche le mur j'obliquerai vers la droite".
L'expérience réussit parfaitement, après de
nombreux zig-zags, et ils se retrouvèrent à l'autre bout du tunnel sans
encombre.
○
○ ○
○
Mon oncle était un véritable casse-cou et il
lui arriva de nombreux accidents avec plaies, bosses, bras cassés, etc.....
Virtuose de l'accordéon, il était très
demandé dans les cérémonies de mariage pour faire danser les invités. Une fois
qu'il revenait d'un mariage en moto, après plusieurs nuits sans sommeil, il se
retrouva dans le lit de la rivière qui bordait la route. Il expliqua alors
qu'en essayant de dormir d'un oeil, le droit, puis le gauche, les deux yeux se
fermèrent en même temps malgré lui.
Il avait fait l'acquisition d'une voiturette
automobile qu'on appelait, à l'époque, cycle-car. C'était un véhicule léger
muni d'un moteur de moto et d'une carrosserie rudimentaire. Un jour qu'il
arrivait à un croisement il vit surgir sur sa droite un gros camion. N'ayant pu
s'arrêter à temps, il vint s'encastrer entre la roue avant et l'essieu arrière
du camion. Le cycle-car fut aplati comme une galette, mais il eut la présence
d'esprit de sauter avant le choc et s'en tira avec quelques plaies.
Un jour qu'il rentrait d'une tournée de
braconnage en montagne, il vit sur la table de la cuisine une bouteille qui
semblait contenir du vin blanc. Comme il avait très soif il s'en versa un verre
et dès que le liquide fut dans sa bouche il se rendit compte de sa méprise. En
fait, la bouteille contenait du "lessif", produit qui sert à confire
les olives. Il rejeta aussitôt cette potion mais le mal était fait et sa langue
se mit à grossir à tel point qu'elle ne pouvait plus contenir dans sa bouche.
Il resta ainsi 48 heures dans ce triste état.
Une autre fois, il passait au Bousquet d'Orb
en moto et, en arrivant devant le magasin de mon père, des chiens qui rôdaient
dans la rue se jetèrent sur la moto et mon oncle se retrouva par terre inanimé.
Relevé dans le coma on le fit transporter chez lui et, dans le pays, on le crût
mort. Mais, le lendemain matin, il se leva à 6 heures et dit à sa femme
"il faut que j'aille voir le curé du Bousquet qui m'attend pour acheter ma
moto".
Malgré tous les accidents qu'il a eu et les
nuits passées à braconner ou à dormir à la belle étoile, il a vécu jusqu'à
l'âge de 92 ans.
○
○ ○
○
Pendant mon enfance, trois de mes camarades
sont décédés dans des circonstances tragiques. Le premier est mort en 48 heures
victime d'une maladie qui faisait des ravages à l'époque: la diphtérie appelée
communément "le croup".
Le second, fils unique du maréchal ferrant,
s'est noyé à l'âge de 12 ans, au cours d'une baignade avec un groupe de
camarades qui l'ont tiré de l'eau rapidement, mais n'ont pu le ranimer.
Le troisième a été victime de sa gourmandise.
Alors qu'il regagnait le collège de Paulhan, où il était pensionnaire, il
profita de l'arrêt en gare de Bédarieux, avant de changer de train, pour
acheter une livre de "biscotins", spécialité de cette ville. Ce
biscuit avait la particularité d'absorber une grande quantité de liquide (comme
une éponge). Il mangea gloutonnement son paquet de biscotins et, en arrivant au
collège, il but une grande quantité d'eau pour étancher sa soif et puis se coucha.
Le lendemain, on le trouva mort dans son lit, étouffé par son estomac qui, en
se dilatant, avait bloqué la respiration.
○
○ ○
○
Il y avait dans un petit village, situé à une
dizaine de kilomètres du B0usquet d'Orb et qui s'appelle Le Coural, une femme qui
était un véritable phénomène. Elle avait l'aspect d'un homme avec une forte
carrure, des bras musclés, des mains et des pieds de grande dimension et une
belle barbe noire. Et pourtant à l'état civil on l'avait enregistré du sexe
féminin, car il lui manquait quelque chose. Elle passait quelques fois au
Bousquet d'Orb avec sa charrette, vêtue d'une longue jupe qui tombait sur des
chaussures énormes, sa barbe étalée sur sa poitrine large et plate et criant
d'une voix forte et grave après son cheval. Elle allait à la gare pour expédier
des caisses de fraises, dont Le Coural était un pays producteur. Les gosses
montaient sur la charrette pour dérober des poignées de fruits et elle les poursuivait
à coup de fouets.
Un jour, elle alla jusqu'à Bédarieux à
l'occasion de la foire pour y faire des achats avec ses vêtements de tous les
jours. Elle fut aussitôt entourée par des habitants de la ville qui n'avaient jamais
vu un tel phénomène. Un agent de police, qui passait par là, l'interpella et
lui dit: "Monsieur, vous devez savoir qu'il est interdit à un homme de
s'habiller en femme. Suivez-moi au commissariat
- Mais, Monsieur l'agent je suis une femme.
- C'est ce que nous allons voir" et il
amena notre phénomène au commissariat.
La "dame" souleva sa jupe et, comme
elle ne portait pas de culotte, l'agent fut stupéfait de ne pas trouver ce
qu'il cherchait. A tel point qu'il appela le commissaire pour voir s'il ne se
trompait pas. Mais celui-ci confirma le diagnostic et il n'y avait plus qu'à relâcher
le phénomène.
○
○ ○
○
Au printemps, mon père recevait des chapeaux
de paille de toutes sortes, pour hommes, femmes et enfants. Les invendus
étaient montés au grenier à la fin de la saison d'été, car la mode changeait d'une
année sur l'autre.
Le grenier était grand, mais à force d'Y
entasser des cartons remplis de chapeaux, il n'y avait plus de place pour y
circuler. Mon père eut l'idée de mettre en vente tous ces chapeaux démodés, à un
prix dérisoire (prix unique 5 sous, soit 25 centimes). Le crieur public avait
annoncé cette vente dans toute la ville et il était spécifié que tout ce qui ne
serait pas vendu serait brûlé.
La vente eut lieu dans la rue un jeudi et, plutôt
que de voir détruire une marchandise périmée, les habitants en achetèrent pour
les conserver comme souvenir. De l'énorme masse de chapeaux qui avaient été
entassés le matin, il ne restait plus qu'un petit tas en fin d'après-midi. On y
mit le feu, devant une foule de curieux, et les enfants sautèrent dans les
flammes comme pour la St Jean.
Le père de Jules Bonhiomme, mon cousin,
revenait un jour de la chasse avec son fusil sur l'épaule et son carnier bien
rempli. Lorsqu'il arriva devant sa porte, les voisins s'approchèrent pour voir
le résultat de cette chasse fructueuse, mais il n'y avait que des champignons
dans le carnier. Les enfants, toujours curieux, voulaient voir aussi le
carnier, mais l'un deux s'intéressa plus particulièrement au fusil. Il toucha
la gâchette, qui était très sensible, et le coup partit car le chasseur, devant
cette abondance de champignons avait omis de décharger son fusil. Jules se
trouvait sur le balcon, juste au-dessus de son père, et il reçut la décharge de
plombs en pleine figure. Il s'effondra en criant avec le visage couvert de
sang. En le voyant ainsi, son père prit le fusil et le cassa en deux avec rage.
Moi, je fondis en larmes et courus auprès de ma mère, car je croyais qu'il
était mort.
En fait, la cartouche contenait du plomb de
petit calibre, pour la chasse aux petits oiseaux, et les blessures n'étaient
que superficielles. Heureusement, aucun plomb n'avait touché les yeux.
○
○ ○
○
Un soir d'été, notre groupe de copains avait
quitté la ville pour chercher un peu d'air frais auprès de la rivière. Il
faisait clair de lune et on y voyait comme en plein jour. Nous décidâmes de nous
baigner en tenue d'adam, nos parents ne nous laissant la disposition des
caleçons que pour l'après-midi.
Nous prenions grand plaisir à ce bain
nocturne, lorsque un de mes copains me signala l'arrivée de mon frère, qui
était en permission, accompagné de sa fiancée. Ils suivaient la voie de chemin
de fer et s'arrêtèrent sur le pont métallique qui enjambe la rivière. Moi, je
restais le plus possible sous l'eau, afin d'échapper à leurs regards, mais mon
frère me reconnut quand même. Il me donna l'ordre de sortir de l'eau en ajoutant,
"je le dirai à maman" ce qui représentait pour moi la perspective
d'une bonne correction.
Je fis remarquer à mon frère que je ne
pouvais pas sortir de l'eau étant tout nu. Sa fiancée se retourna et je sortis
rapidement pour aller m'habiller sous le pont.
Pour éviter la correction qui m'attendait, il
était indispensable que je vois mon frère avant qu'il ne rentre à la maison. A
cet effet, le groupe de copains s'était divisé en deux afin de surveiller son
arrivée par le nord ou par le sud de notre rue. Moi, j'étais entre les deux
groupes dans l'attente du signal m'indiquant le point d'arrivée de mon frère.
Dès que je l'entendis, je courus vers lui en implorant son pardon et en
promettant de ne pas recommencer. J'obtins gain de cause et courus rejoindre
mes camarades pour terminer gaiement cette soirée.
○
○ ○
○
Tous les ans, nous allions à la fête de
Roqueredonde, (Tieudas pour les gens du pays), où habitaient les parents de la
mère de mon père. Il y avait la tante "Camboune" (Cambon, en
français), qui tenait le café et des
cousins, maréchal ferrant chez qui nous logions.
Cette fête avait lieu en hiver et sur ce
plateau de l'Escandorgues il y avait beaucoup d'oiseaux migrateurs, notamment
des grives qui trouvaient une nourriture abondante sur les genévriers. Avec les
lièvres et autres gibiers, les tables étaient bien garnies.
Et puis il y avait la "fouace",
pâtisserie en forme de couronne qui est une spécialité de la région. La
Camboune en fabriquait des quantités industrielles qui étaient stockées dans
l'arrière salle du café. Avec mes petits cousins nous allions souvent quémander
un morceau de fouace et la tante nous en donnait une grosse part en disant, en
patois, "manga né et qué té créba" (manges en et que çà te crève).
Une année, il y avait avec nous un oncle de
mon père, célibataire endurci et gros buveur, mais il logeait chez nos cousins
du Furou, en dessous de Tieudas. Une nuit, où il avait bu encore plus que de
coutume, il fit une centaine de mètres sur le chemin du Furon et puis il
s'abattit sur le sol, les bras en croix. Pendant la nuit la neige se mit à
tomber mais elle fondait au fur et à mesure sur son corps chauffé par l'alcool.
Au petit matin, il s'éveilla et, une fois relevé, il y avait sur le sol sa
silhouette artistement dessinée. Tous les habitants du village venaient voir ce
beau travail de la nature.
○
○ ○
○
C'est en 1917 que je fis mon premier grand
voyage en chemin de fer. Avant la guerre mes parents m'avaient amené à Sète,
pour voir la mer, et à Montpellier chez une soeur de mon père. J'allais tout
seul à Millau ou à Mende à la fin de chaque congé scolaire, mais ce n'était que
de courts trajets.
En Décembre 1917, mes parents recevaient des
nouvelles alarmantes de mon frère qui se plaignait d'être malade et demandait de
l'argent pour se soigner. Ma mère a profité de ce que j'étais en vacances pour
que j'aille avec elle à Toulon, car elle était incapable de faire un tel voyage
toute seule, mon père étant obligé de s'occuper de l'épicerie.
A cette époque de la guerre, les chemins de
fer étaient désorganisés en ce qui concerne le transport des voyageurs civils,
priorité étant donnée aux transports militaires (permissionnaires, déplacements
de troupes, de matériel et de munitions). Les horaires n'étaient pas respectés
et les trains étaient supprimés sans préavis.
Nous partîmes un soir à 17 heures, et arrivés
à Bédarieux, nous apprîmes que le train pour Montpellier était supprimé.
Nous étions prêts à faire demi-tour lorsque
nous aperçûmes un soldat de chez nous qui s'apprêtait à monter dans un train de
permissionnaires.
Il nous fit monter dans son compartiment
en,expliquant à ses camarades que nous étions ses parents et que nous allions
voir un blessé à Tarascon. Mais il y avait un contrôle effectué par deux
officiers et quand ils nous virent ils voulurent nous faire descendre. Ils
reçurent une bordée d'injures de la part des soldats qui les traitèrent
d'embusqués. A cette époque, il y avait eu des mutineries dans l'armée, aussi
les deux officiers filèrent en douce.
Le train arriva à Tarascon vers minuit et il
me fut impossible de savoir l'heure du prochain train pour Marseille. Comme il
faisait très froid, nous nous sommes réfugiés dans la salle d'attente et,
chaque fois qu'on entendait le bruit d'un train, nous allions sur le quai, mais
le train ne s'arrêtait pas. Enfin un train s'est immobilisé sur le quai et nous
sommes arrivés à Marseille.
Nouvelle incertitude pour le train qui devait
nous amener à Toulon. Après deux heures d'attente, on nous fit monter dans un
train complètement vide et non chauffé, mais un quart d'heure plus tard nous
étions invités à descendre, ce train ne partant plus.
Nous étions revenus dans la salle d'attente
lorsque ma mère s'aperçut qu'elle n'avait plus son sac à main. Je partis
aussitôt sur le quai que j'avais heureusement repéré lorsque nous étions montés
dans le train et je me souvenais que nous avions pris le premier compartiment
du deuxième wagon. Le train était encore là et le sac à main était resté sur l'extrémité
de la banquette. J'étais heureux de rapporter le sac à ma mère, car notre
voyage aurait été compromis puisqu'il y avait dedans les billets de chemin de
fer et tout l'argent.
En fin de matinée un nouveau train pour
Toulon fut annoncé et nous arrivâmes dans cette ville vers 13 heures. Mon frère
n'était pas à son travail et nous eûmes bien du mal à le trouver, ne
connaissant pas l'adresse de son hôtel.
Par ses camarades que nous vîmes à la Préfecture
Maritime nous pûmes le joindre et, comme ma mère s'étonnait de le voir en bonne
santé, il finit par avouer qu'il avait une dette de jeu et qu'il avait besoin
d'argent pour la rembourser.
Ma mère estima que c'était moins grave qu'une
maladie et le lendemain matin nous reprenions le train pour le voyage de retour
qui dura deux jours.



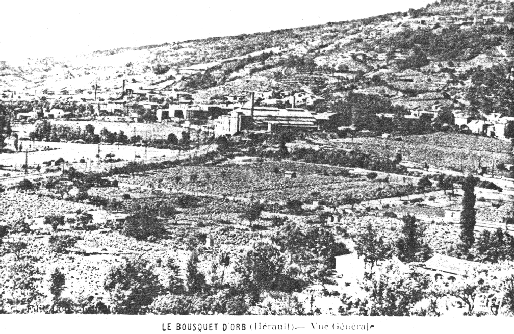

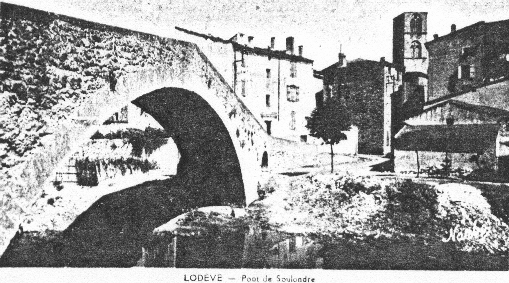





 Au Collège
Au Collège La Boutique familiale
La Boutique familiale